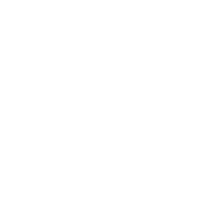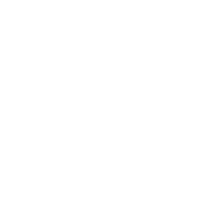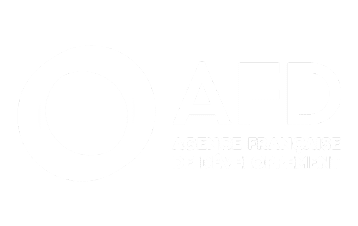La CTM a voté en 2023 lors d’une plénière, la promotion d’une filière de plantes indigènes issues de semences sauvages et Martiniquaises, conservant la traçabilité des plants. En effet, les végétaux sauvages et locaux sont porteurs d’adaptations génétiques spécifiques dans chaque île. C’est pourquoi le CBNMq accompagne la CTM dans le déploiement de cette filière, sur le volet scientifique et technique. Pour acheter ces végétaux de qualité en Martinique, il faut aujourd’hui réaliser des commandes de récoltes et mises en culture, sur lesquelles le CBNMq peut réaliser un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement peut être :
- le choix des espèces,
- la rédaction du cahier des charges, ou
- la formation à la récolte et semences de graines sauvages.
Pour faciliter la prescription et la disponibilité des végétaux, sans passer par ce travail, nous encourageons l’adhésion à la marque Végétal Local, dont le référentiel technique est désormais adapté aux Outre-Mer.
Végétal local est une “marque collective simple”, c’est-à-dire que tout le monde peut la produire à condition d’être adhérent et de respecter le référentiel technique. Ce référentiel garantit alors à l’acheteur de végétaux labellisés”Végétal local” une traçabilité des végétaux vers le milieu naturel dont il est issu, qu’ils sont alors autochtones et Martiniquais et même, qu’ils n’ont pas été sélectionné ou croisé. C’est une garantie pour la conservation des écosystèmes et la génétique des plantes afin d’avoir sur le marché des gammes adaptées pour tous les types d’aménagement jusqu’à la restauration.
Pourquoi utiliser des plantes indigènes ?
“Plant peyi a bel !”
C’est une alternative tout à fait ornementale et durable aux plantes exotiques potentiellement envahissantes. Par exemple :
- Bwa pissenlit – Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth ;
- Fwanjipanyé blan lokal – Plumeria alba L. ou ;
- Savonnèt rivyè – Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.
Présentent tout autant de qualités esthétiques et remplacent parfaitement certaines exotiques en Martinique.
- Bwa pissenlit – Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth , BIGNONIACEAE
- Fwanjipanyé blan lokal – Plumeria alba L., APOCYNACEAE
- Savonnèt rivyè – Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC, FABACEAE
Identité paysagère
Nos paysages des Petites Antilles sont singuliers avec leurs végétaux indigènes, ils habillent le territoire d’une identité forte. En revanche, les paysages plantés d’exotiques, surtout envahissantes, proposent un paysage mondialisé, à l’instar des plages de cocotiers.
- Coccoloba uvifera (L.) L., POLYGONACEAE, Raisinier bord de mer.
Déjà adaptées à nos écosystèmes
Les plantes indigènes sont déjà adaptées au territoire et à ses habitats.
- Exemple d’adaptation, à la Pointe Borgnèse au Marin.
Moins de pesticides & plus d’interactions avec la faune
Puisqu’elles sont déjà adaptées au territoire, elles sont moins sensibles aux maladies ! Elles nécessitent moins d’entretien et moins de pesticides. Un point en faveur, notamment, des pollinisateurs. Développer les plantes indigènes, c’est également permettre l’accueil et l’interaction naturelle faune-flore.
- Dryas iulia (Fabricius), NYMPHALIDAE, papillon “Flambeau” butinant une inflorescence de Verbesina gigantea Jacq., ASTERACEAE, “Kanmonmiy” au Morne Larcher, le Diamant..
Pourquoi utiliser des plantes issues de graines, locales et sauvages ?
Restauration des services écosystémiques
- Barrière contre les évènements extrêmes
- Maintien des sols, sédiments et nutriments
- Epuration de l’eau et des sols
- Refuge pour pollinisateurs et autres auxiliaires
- Etc.
En préservant leur diversité génétique par la reproduction sexuée, on accompagne le potentiel adaptatif des espèces aux changements climatiques pour l’avenir du territoire. Ainsi, les plantes indigènes sont la base des solutions fondées sur la nature.
Compétences et maîtrise locale
Développer la connaissance et la compétence de production de plantes indigènes et leur reproduction naturel, c’est développer :
- la création d’activités économiques innovantes ;
- une diversité de métiers ancrés dans le territoire ;
- un usage et une gestion durable de ressources entièrement locales ;
- des acteurs multiples qui travaillent ensemble pour la Martinique.
- Hugo, technicien ex situ, à la pépinière de Fort de France.
Quelles sont les ambitions?
Les 5 grands principes pour cette filière :
- Espèce indigène
- Espèce qui ne soit pas rare et menacé
- Reproduction sexuée
- Graine sauvage martiniquaise
- Récolte en PETITES QUANTITÉS, sur des sites et des semenciers VARIÉS
Le but :
- Proposer des plantes adaptées et durables pour le territoire ;
- Constituer des corridors pour les espèces, notamment rare et menacée ;
- Garantir une diversité génétique et le non pillage des plantules ;
- Préserver un patrimoine génétique autochtone ;
- Éviter toute pression sur l’écosystème et toute forme de sélection, qu’elle soit volontaire ou involontaire.
Traduction en règle, que ce soit dans le référentiel technique de Végétal local ou des cahier des charges de commandes pour la récolte et la mise en culture :
- S’assurer que les individus collectés sont bien issus de la RÉGION D’ORIGINE, sont indigènes, SAUVAGES, non hybridés et NON ISSUS DE SÉLECTION HUMAINE (même involontaire).
- Réaliser des fiches de TRAÇABILITÉ des collectes en précisant l’habitat en prenant comme référentiel d’habitats Portécop 1979.
- Constituer chaque lot de graines à partir d’au moins 15 INDIVIDUS pour les espèces disséminées, préférentiellement répartis sur plusieurs sites. On peut être plus ambitieux pour les espèces grégaires comme les palétuviers.
- Collecter sans dépasser un prélèvement de 25% DES GRAINES produites annuellement par l’individu collecté.
- Effectuer un MAXIMUM DE 3 ANNÉES consécutives de collecte sur un même site.